Classes préparatoires – Muriel Darmon
Par Société des agrégés, le 13 décembre 2013
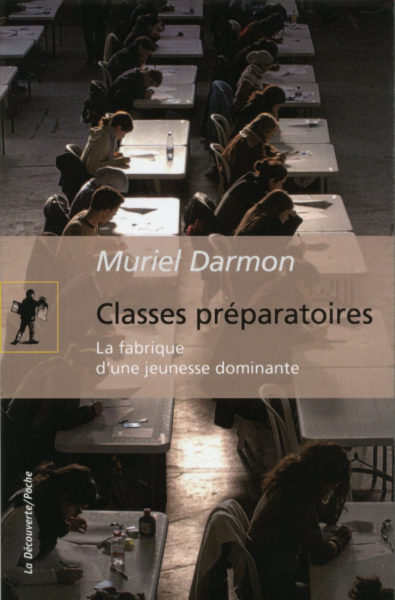
Muriel Darmon est sociologue et directrice de recherche au CNRS dans le Centre européen de sociologie et de science politique (CNRSEHESS-Paris I) a publié Classes préparatoires, La Fabrique d’une jeunesse dominante en 2013.
Vous avez décidé de consacrer votre ouvrage à la formation délivrée aux élèves dans les classes préparatoires parce que vous vouliez demander non pas « d’où viennent-ils » ou « que deviendront-ils » mais « que deviennent-ils » ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a poussée à adopter cette démarche ?
J’ai choisi de construire mon questionnement de cette façon dans la mesure où les deux autres questions sont à la fois posées, et pour une large part résolues, par les statistiques disponibles. On sait « d’où viennent » les élèves – d’où ils continuent à venir –, à savoir dans leur grande majorité des familles de cadres, de professions libérales et de professions intellectuelles supérieures. On sait aussi « ce qu’ils deviendront », dans la mesure où les statistiques disponibles l’indiquent – par exemple la quasi- totalité des élèves des écoles scientifiques et de commerce deviendront cadres du privé. En revanche, la sociologie s’était très peu penchée sur la boîte noire que constituaient les années préparatoires elles-mêmes, et je souhaitais à la fois faire porter le regard sociologique sur ce moment-là de leur trajectoire scolaire, et les approcher au moyen d’une méthode de type ethnographique, par observations et entretiens, attentive aux processus, aux pratiques et aux expériences des différents membres de l’institution préparatoire.
Vous commencez par décrire très précisément la sélection et la définissez comme une quête de « l’énergie scolaire » des candidats aux classes préparatoires. Quel regard portez-vous sur cette sélection ? Vous semble-t-elle justifier les critiques émises contre ce type de classe ?
Le recrutement « objectif » des classes préparatoires, comme je le dis ci-dessus, ne laisse aucun doute sur leur composition sociale biaisée vers le haut de l’espace social. En revanche, ni les classes préparatoires ni les commissions d’admission ne sont responsables de cette situation. Les commissions ne chassent pas les enfants de la bourgeoisie avec un filet à papillons pour les enrôler en classes préparatoires : ils classent les demandes qui leur parviennent en fonction de critères (de niveau et d’attitude scolaires) qui leur sont propres, et c’est du fait des inégalités sociales devant l’école, ainsi que de leur position en bout de chaîne du système d’enseignement, qu’ils vont reproduire et contribuer à renforcer ces inégalités. Le travail des commissions consiste à repérer chez les élèves non pas seulement un niveau scolaire, élevé, mais une certaine forme de potentialité qui correspond à mon sens au degré anticipé de « travaillabilité » de l’élève par l’institution. En m’appuyant sur Foucault, je désigne en effet par le terme d’« énergie scolaire » ce mixte de capacité scolaire et d’obéissance qui fait le « bon candidat » de classes préparatoires.
À un moment vous abordez avec les étudiants la question de « la vie entre parenthèses ». Vous a-t-il semblé que leurs réactions étaient inspirées par le milieu dont ils étaient issus ? Que certains sont davantage préparés que d’autres ou supportent mieux la pression ?
D’une manière générale, le discours des enquêtés élèves est assez consensuel sur le fait que la prépa consiste « à mettre sa vie entre parenthèses » pendant deux ans. Les positions que j’ai qualifiées d’ultra-scolastiques – comme cette élève de classe préparatoire scientifique qui me dit que « sa vie, c’est les Maths », donc qu’elle n’est en rien mise entre parenthèses en prépa – sont rares même si elles existent. Mais le milieu d’origine des élèves peut cependant influer sur cette homogénéité apparente, de façon ambivalente d’ailleurs. Pour certains enfants de milieux populaires, à la difficulté scolaire de la vie en prépa s’ajoute une difficulté « sociale », celle du « choc culturel », du sentiment de n’être pas « à sa place » en prépa. Pour d’autres au contraire, c’est le luxe du loisir dans l’étude qui caractérise la vie préparatoire, qu’ils comparent au travail en usine de leurs parents au même âge, ou à l’insécurité qui guette ceux de leur famille qui ont « arrêté l’école » ou fait des « études courtes ».
Vous dites que la classe préparatoire fait de l’élève un « maître du temps ». Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs ce que vous entendez par là ?
En fait, la maîtrise temporelle est une figure, quasi mythique, avant même d’être incarnée dans des personnes. Dans les classes préparatoires où règnent l’urgence et les différentes formes de la « panique temporelle », certains élèves sont décrits comme ayant les moyens de s’abstraire de l’urgence commune, d’être « synchrones » avec les enseignants (les « maîtres » du temps par excellence, évidemment !) et avec le rythme des cours et des révisions, pouvant décider calmement de l’allocation de leur temps, s’arrêter de travailler (et non se noyer dans le travail) pour « faire autre chose », voire « avoir une vie à côté de la prépa ». En pratique, tous les élèves sont soumis à la discipline temporelle et à l’urgence. En revanche, ceux qui parviennent à approcher de plus près ces postures de maîtrise temporelle sont les élèves les plus favorisés socialement, quand les cas les plus patents de retard et d’échec temporels, pour le dire comme cela, sont le fait de certains des élèves de classes populaires. Les rapports au temps, incorporés au cours d’une socialisation familiale et primaire de classe, sont une des formes prises par les inégalités sociales devant l’école.
Vous semble-t-il, à la fin de ce travail, que les classes préparatoires sont représentatives d’une certaine époque, en bref, le modèle de la classe préparatoire existe-t-il encore ? Est-il dépassé à votre avis, comme on l’entend dire parfois ? À quoi serait-il adapté ?
Je ne saurais dire s’il est « dépassé » ou « adapté », en revanche l’ethnographie permet de répondre à la critique qui est faite aux classes préparatoires de se complaire dans un splendide isolement scolaire, en montrant comment les avenirs probables des élèves, y compris même professionnels (d’ingénieurs pour les prépas scientifiques, de managers pour les prépas économiques), travaillent par anticipation le présent de leurs années préparatoires. De même, la sociologie – comparée cette fois – permet de montrer qu’un système d’enseignement supérieur uniquement universitaire, comme celui des États-Unis, s’accompagne tout autant que le système français d’un enseignement à deux vitesses fortement inégal socialement, et de la version américaine des classes préparatoires que sont les elite boarding schools qui préparent des étudiants privilégiés (y compris économiquement) à entrer à Harvard ou Princeton.
Pourquoi achever votre livre sur une phrase du Guépard ? Qu’est-ce qui change pour que rien ne change ? Est-ce un constat pessimiste ?
Vous pourriez dire que c’est l’ancienne khâgneuse en moi qui finit ainsi sur une phrase du Guépard – après avoir terminé mon précédent livre sur une paraphrase de la Merteuil des Liaisons Dangereuses… Ce que je voulais exprimer ainsi, c’est le choc du rapprochement entre des évolutions historiques ou biographiques nombreuses, de l’institution préparatoire, des enseignants et des élèves, avec la stabilité opiniâtre de l’élitisme social du recrutement. Beaucoup de choses ont semble-t-il changé depuis la « prépa à l’ancienne », l’institution s’est diversifiée, elle s’est adoucie, de nouvelles matières sont apparues, de nouvelles filières, de nouveaux programmes ou manières de le transmettre, le rôle des enseignants s’est modifié, les élèves aussi ont changé, et « ils changent » au cours de leurs années de prépa. Donc tout change, mais « rien » ne change du point de vue des bénéficiaires et des exclus de ce système. Certaines évolutions ont sans doute même pour effet de permettre à la reproduction sociale de se reproduire : je pense par exemple à l’importance semble-t-il grandissante, en prépa économique, de ce que les sociologues appellent « capital international » – aisance linguistique et familiarité avec les pays et cultures étrangères – qui, pour moderne et ouvert qu’il soit, est aussi profondément inégalitaire, économiquement comme culturellement. Pour que « tout » change vraiment, ce sont les statistiques nationales de recrutement qui doivent changer.
Merci à Muriel Darmon, Sciences sociales 1996